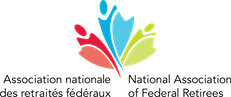Adam Houston a survécu plusieurs années dans un camp de prisonniers de guerre japonais et vient de célébrer ses 100 ans.
« Mon Dieu, non », dit M. Houston, depuis sa résidence pour retraités à Burlington, en Ontario. « Cela m’est juste revenu, une année après l’autre ».
Ce passage à tabac brutal remonte à près de 80 ans, et M. Houston sourit et glousse même en se remémorant ce moment — et un siècle de moments — au cours d’une entrevue vidéo sur Zoom. Même une connexion sans-fil instable ne le déstabilise pas. Il y a longtemps que cet homme a appris à encaisser les coups de poing littéralement, sans oublier les coups de pied, les balles, les missiles, les bombes et les maladies qui ont failli le tuer dans sa jeunesse.
Il a survécu et est retourné en Écosse, a émigré au Canada, a trouvé un emploi à Postes Canada et a été le deuxième membre de la Section de Hamilton de l’Association nationale des retraités fédéraux.
M. Houston est né le 22 mai 1921 à Selkirk, en Écosse. Commençant à travailler à l’âge de 14 ans, il a passé quatre ans dans une usine de tweed, ce qui est peut-être bien l’emploi le plus écossais d’un Écossais. Il a fait des études sur les textiles, faisant montre de ce qu’il décrira plus tard dans son journal de guerre comme une « soif d’apprendre ».
À 18 ans, il s’engage dans l’armée territoriale.
« On travaillait toute la journée et on était soldat le soir, la fin de semaine et pendant les vacances. Cela n’a pas duré très longtemps car, en septembre bien sûr, la guerre a commencé », se souvient-il, se rapprochant de l’écran de l’ordinateur pour mieux entendre les questions. « Quelques jours avant que [le premier ministre britannique Neville] Chamberlain ne déclare la guerre, j’ai été appelé à servir à plein temps, dans le King’s Own Scottish Borderers. »
Ce régiment d’infanterie a fait de lui un transmetteur, responsable de l’équipement radio et des communications. Rapidement, il est envoyé en Malaisie et affecté à une unité antichar. Ils étaient à Singapour, et vivaient une belle aventure, jusqu’à ce que les choses changent.
« Quand la guerre est arrivée, elle est arrivée sans prévenir », a-t-il écrit dans son journal. « On nous a dit qu’un convoi de navires japonais avait été aperçu et que nous devions nous rendre au nord pour prendre nos positions à la frontière [thaïlandaise]. »
Le 2 octobre 1942, il reçoit un message radio : « Il ne faut pas penser à épargner les troupes ou la population civile et il ne faut faire preuve d’aucune pitié pour une quelconque faiblesse, sous quelque forme que ce soit. Les commandants et les officiers supérieurs doivent diriger leurs troupes et, au besoin, [mourir] avec elles », ordonnait le général Archibald Wavell.
Malgré les fanfaronnades du général, les Japonais avaient la supériorité militaire. Au bout d’un mois, les forces britanniques et alliées avaient capitulé. M. Houston a alors reçu l’ordre discret de « préparer » sa radio, pour que l’armée japonaise en approche ne puisse l’utiliser. « Après avoir été occupé avec une paire de pinces pendant cinq minutes », a-t-il écrit dans son journal, « il est extrêmement douteux que le poste de radio puisse à nouveau fonctionner avec succès. »
Après une marche forcée, au cours de laquelle ils voient des prisonniers malaisiens massacrés par des soldats japonais, son groupe arrive au camp de Changi. Peu après, la dysenterie attaque. « J’ai été l’un des premiers malchanceux. » Après deux semaines d’hospitalisation, malgré son grand amaigrissement et le fait qu’il se sente toujours mal, on lui signifie son congé à cause d’une pénurie de lits.
« J’ai piqué une couverture et une moustiquaire indispensables à l’hôpital, et je me suis préparé à rejoindre les gars », écrit-il, encore capable de plaisanter. « Le sergent japonais responsable parlait un peu l’anglais, qu’il avait apparemment appris au cinéma. Il était très peiné lorsque nous lui avons dit que Deanna Durbin [la star des comédies musicales du cinéma née à Winnipeg] était décédée. »
Après une autre marche forcée, les prisonniers ont été fourrés dans un « navire de l’enfer » japonais, un vieux bateau à vapeur qui avait été réaménagé pour le transport des prisonniers. « Chaque pont de ce navire était divisé en deux, nous étions donc entassés comme sur des étagères », raconte M. Houston. Chaque espace faisait « environ 50 pouces de haut », pense-t-il, et le voyage durait deux semaines. « On avait juste assez d’espace pour s’allonger », se souvient-il. Dans son journal, il écrit : « Dans ces trous, les hommes étaient entassés comme de vieilles bottes dans un placard ».
Le 14 novembre, ils atteignent Formose (Taïwan, aujourd'hui). Après une autre marche forcée en montagne, ils arrivent au camp de prisonniers de guerre de Kinkaseki, près de Taipei. Ils allaient travailler dans une mine de cuivre.
M. Houston n’était pas complètement remis de la dysenterie, mais le contremaître japonais, surnommé Croc doré en raison d’une dent en or saillante, n’en avait cure.
Adam Houston s’est enrôlé dans l’armée territoriale en Écosse en 1939 et a suivi une formation de transmetteur.
« Je ne travaillais pas assez dur, alors au repas de midi, alors que les autres retournaient au travail, il m’a empoigné et battu avec un manche de pioche. Il m’a laissé par terre et m’a donné quelques coups de pied. À la fin du quart de travail, les autres prisonniers m’ont transporté, en terrain montagneux, et ramené au camp. » Faisant pour le moins preuve d’euphémisme, il ajoute : « Ce fut assez remarquable. »
Il n’a jamais revu la mine de cuivre. Il était si malade et si faible qu’il a passé des mois dans le coma à l’hôpital et a reçu des soins médicaux jusqu’à la fin de la guerre.
Après avoir passé trois ans et demi dans des camps de prisonniers de guerre, M. Houston est revenu à Selkirk en 1946. Il a occupé plusieurs emplois, dont agent d’assurance, machiniste, organisateur du Parti libéral écossais, ainsi que dans une usine de tweed. Un jour, il a vu « une annonce dans les journaux locaux, demandant aux gens de venir en Ontario ». Il a donc acheté un billet d’avion — il se souvient de la compagnie aérienne (KLM) et du prix (65 livres) — et a traversé un autre océan. C’était en 1956. Sa femme, Agnes Cockburn Dunse, et leur unique enfant, Marion Elizabeth, l’ont rejoint un an plus tard.
« Son nom de famille était Dunse, parce que son arrière-grand-père était un enfant trouvé », explique M. Houston. « On l’a trouvé sur les marches de la mairie de la ville de Dunse, alors qu’il était bébé. » Il s’empresse d’ajouter qu’Agnès « était une Écossaise tricotée serrée ».
Ils se sont rencontrés en 1946 lors d’un bal costumé organisé par l’employeur de celle-ci.
« J’ai dit à cette fille : “Personne ne m’a demandé d’aller à ce bal” et elle m’a répondu : “Je trouverai quelqu’un pour t’y emmener”. Et la personne qu’elle a trouvée est devenue ma femme. Après le bal, j’ai raccompagné Agnès chez elle. Elle m’a dit : “Tu peux m’embrasser si tu veux, mais ça ne veut rien dire.” Cela a pourtant bien dû signifier quelque chose, car quelques années plus tard, nous étions mariés. »
À Toronto, il décroche un emploi de trieur au bureau de poste. Gravissant les échelons jusqu’au poste de superviseur, il a étudié trois ans pour obtenir un certificat de service public et trois autres années en ressources humaines, à ce qui s’appelait alors Ryerson Polytechnique. Lorsqu’il a pris sa retraite en 1981, il était « gestionnaire de ligne postale de niveau 5" à la succursale South Central, à Toronto, et est devenu vice-président de la Section de Hamilton de Retraités fédéraux.
« À l’époque, nous tentions seulement de nous établir. Nous devions nous assurer que les gens entendent un boniment pour devenir membre avant de prendre leur retraite, parce que jusqu’à l’obtention des retenues de cotisation sur les chèques de pension, il fallait faire une tournée pour percevoir les cotisations », dit-il, en riant de bon coeur.
Agnès est décédée il y a six ans, mais elle a pu l’accompagner à Taïwan en 2005 pour l’ouverture d’un « parc du souvenir » à l’emplacement de l’ancienne mine de cuivre.
« Ils ont été très gentils avec nous », se souvient-il. « C’était une très belle cérémonie. Ils ont transformé ce qui avait été un camp atroce en parc plutôt attrayant. » Il est maintenant le dernier des quatre survivants qui étaient encore en vie lors de ce retour sur les lieux.
« On s’est bien occupé de nous, et le président de Taïwan a insisté pour que les prisonniers lui parlent personnellement, alors nous avons pu le rencontrer », dit-il. « Ensuite, il a payé notre dîner au Grand Hôtel. Un geste sympathique. »