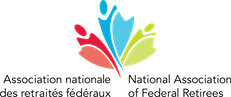Dans un monde postpandémique, l’appel en faveur d’une convention des Nations Unies sur les droits des personnes âgées n’a jamais été aussi convaincant.
La pandémie a révélé des inégalités flagrantes dans la société, surtout en ce qui concerne la façon dont nous traitons ses doyens. À l’échelle mondiale, la majorité des personnes qui sont décédées en raison du virus étaient âgées. De plus, la situation a entraîné de nombreux autres décès, non pas en raison de la COVID, mais plutôt d’autres problèmes, qui étaient parfois causés par l’impossibilité d’obtenir les soins nécessaires en temps opportun.
Ajoutons à cela le grand nombre de crises humanitaires et de conflits dans le monde ainsi que les vulnérabilités supplémentaires des personnes âgées dans de telles situations, l’appel en faveur d’une convention des Nations Unies sur les droits des personnes âgées devient d’autant plus convaincant.
Comme Bridget Sleap, chercheuse principale en droits des personnes âgées chez Human Rights Watch, le mentionne, le cadre international actuel des droits de la personne ne protège pas convenablement les droits des personnes âgées à l’heure actuelle.
« Cela a différentes conséquences », explique Mme Sleap. « Cela a une incidence sur la protection de ces droits dans la législation nationale, sur la façon dont les politiques, les programmes et les services pour les personnes âgées sont conçus. Cela affecte aussi l’allocation budgétaire pour ces types de services ainsi que la priorité qui leur est accordée; des facteurs faisant en sorte que les personnes âgées peuvent être victimes de discrimination et être privées de leurs droits. »
« Il y a beaucoup d’arguments en faveur d’une convention pour veiller à la protection des droits des personnes âgées de façon équitable par rapport à ceux des autres membres de la société. »
Mme Sleap souligne qu’une convention aurait également pour effet d’accroître la visibilité des personnes âgées à titre de titulaires de droits.
« Une convention enverrait un signal fort au monde entier que nos droits ont la même importance lorsque nous sommes plus âgés qu’à n’importe quelle autre époque de nos vies. »
Claudia Mahler, experte indépendante sur les droits des personnes âgées pour les Nations Unies, indique que les problèmes auxquels font face les personnes âgées sont systémiques et structurels.
« Une convention entraînerait de profonds changements dans le système, puisqu’elle susciterait une sensibilisation accrue. Elle permettrait de guider les États », déclare Mme Mahler. « Cela leur indiquerait très clairement la voie que nous devons suivre. »
Elle mentionne que des outils comme les conventions, lors de leur mise en œuvre, peuvent avoir une énorme incidence à l’échelle nationale, phénomène dont elle a été témoin avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Ironiquement, cela pourrait entraver le succès de la convention proposée, car même les pays développés qui estimaient faire du bon travail en matière d’adaptation pour les personnes en situation de handicap ont découvert qu’ils avaient du pain sur la planche après l’adoption de la convention. Cela pourrait rendre les gouvernements réticents à réitérer l’expérience avec un tout nouveau groupe social.
Ce qui doit maintenant être fait
L’année en cours est importante pour les personnes ayant consacré des efforts à mettre en œuvre une convention. Deux ambassadeurs ont été désignés pour étudier les travaux réalisés au cours des dix dernières années et pour formuler des recommandations sur la façon de procéder.
La convention a déjà obtenu un appui considérable, 19 pays d’Amérique latine et des Caraïbes, 10 pays d’Europe, y compris le Royaume-Uni, 23 pays d’Afrique et 10 pays de la région Asie-Pacifique s’étant déclarés en faveur de celle-ci. Pourtant, un seul pays nord-américain, le Mexique, a exprimé son soutien.
Mme Mahler indique qu’un État membre des Nations Unies doit parrainer la convention lors de la réunion de mai du Groupe de travail à composition non limitée des Nations Unies sur le vieillissement.
« J’espère qu’un État membre prendra la parole et affirmera : “Je vais rédiger une ébauche de la convention, puis nous verrons si nous parvenons à convenir de sa version définitive” », souhaite Mme Mahler. « C’est ainsi que cela s’est passé pour la CDPH [Convention relative aux droits des personnes handicapées]. »
Pour la CDPH, explique-t-elle, le Mexique désirait créer son propre legs et a proposé de la rédiger.
« Cela a non seulement suscité un élan, mais a généré quelque chose de concret », indique-t-elle. « Nous ne pouvons pas nous contenter de nous asseoir chacun de notre côté, ne disant que oui ou non. »
Mme Mahler n’a aucune idée du pays qui pourrait reprendre ce flambeau.
« Si vous me l’aviez demandé il y a deux ans, j’aurais songé au Canada, mais ce n’est plus le cas maintenant », mentionne Mme Mahler. Elle a tenté de faire intervenir des collègues des Nations Unies dont les portefeuilles se chevauchent, mais elle explique que pratiquement personne d’autre au sein des Nations Unies n’a de responsabilités associées aux personnes âgées. « Nous devons vraiment pointer du doigt les gouvernements qui refusent de soutenir leurs citoyens âgés, qui représentent une grande proportion de leur population et qui méritent également de jouir de leurs droits. Il y a beaucoup de violence à l’égard des personnes âgées dans le monde de nos jours. »
Il faut aussi tenir compte des catastrophes naturelles. Les plans d’évacuation en cas d’urgences environnementales ne tiennent pas compte de ce dont les personnes âgées ont besoin pour les aider à évacuer. En situation de guerre ou de conflit, l’aide humanitaire ne considère pas toujours ce dont les personnes âgées auront besoin.
« Nous l’avons observé en Ukraine, où ils n’étaient pas outillés pour faire face à ce type d’enjeux », rapporte Mme Mahler. Entretemps, à Gaza, des personnes âgées meurent de faim, puisqu’il est difficile d’acheminer de la nourriture et d’autres formes d’aide dans la région. Le problème est exacerbé par une situation que l’organisation HelpAge International décrit comme : « une tendance émergente selon laquelle certaines personnes âgées se privent de nourriture pour que de jeunes enfants puissent manger. »
Victimes de mauvais traitements
Un rapport de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) paru en 2022 a révélé qu’une personne âgée de 60 ans et plus sur six a vécu une certaine forme de mauvais traitement dans sa collectivité au cours de l’année précédente. Entretemps, les deux tiers du personnel d’établissements comme ceux de soins de longue durée ont reconnu avoir commis des actes de maltraitance au cours de l’année précédente. Selon ce même rapport, les taux de maltraitance des personnes âgées ont augmenté durant la pandémie de COVID-19 et la population âgée de 60 ans et plus devrait au moins doubler d’ici 2050, un point de vue justifiant à lui seul la nécessité de passer à l’action.
L’OMS définit la maltraitance des personnes âgées comme étant un « acte unique ou répété, ou en l’absence d’intervention appropriée, dans le cadre d’une relation censée être une relation de confiance, qui entraîne des blessures ou une détresse morale pour la personne âgée qui en est victime. » De tels mauvais traitements violant les droits de la personne peuvent être de nature physique, sexuelle, psychologique, émotionnelle, financière ou matérielle. L’abandon, la négligence et l’atteinte grave à la dignité ainsi que le manque de respect en font également partie.
Dans son propre rapport annuel paru en 2023, qui étudiait la violence à l’égard des personnes âgées, Mme Mahler souligne que les données relatives aux expériences de violence, de mauvais traitements et de négligence des personnes âgées sont pratiquement inexistantes, du moins au-delà de celles rapportées par l’OMS l’année précédente.
« En raison de ces difficultés, on suppose que les nombres réels de personnes âgées victimes de mauvais traitements ou de violence sont considérablement plus élevés que les données existantes l’indiquent et, qu’en raison du vieillissement de la population mondiale, ils augmenteront rapidement à l’avenir si l’on ne prend aucune mesure pour s’attaquer efficacement à ce problème », écrit-elle.
Quelles sont les raisons de cette réticence?
Pour Mme Sleap, l’argument prédominant des États membres s’étant prononcés contre la convention est que le système actuel en matière de droits de la personne est suffisant, que les personnes âgées jouissent des mêmes droits que tout le monde et sont donc protégées par ceux-ci.
Mme Sleap estime cependant que, dans la même mesure, ces États ne veulent pas être tenus de satisfaire à un autre ensemble de normes relatives aux droits de la personne.
« Il existe une certaine opposition par rapport au fait de devoir faire respecter des droits de la personne et d’être examiné attentivement quant à la façon dont on le fait », indique Mme Sleap.
Mme Sleap mentionne que le Canada s’est d’abord opposé à la convention, mais que cette position s’est assouplie au cours des dernières années, bien qu’il n’ait pas encore déclaré qu’il l’appuie.
Lorsque la question lui est directement posée, le bureau du ministre des Aînés répond ceci : « Le Canada continue de participer aux discussions relatives à la convention des Nations Unies sur les droits des personnes âgées avec des intervenants et des partenaires, à l’échelle nationale et internationale. »
Parmi les autres pays n’ayant pas exprimé leur appui, on en retrouve certains qui ont un piètre bilan en matière de droits de la personne. D’autres pays figurant sur cette liste, cependant, font meilleure figure en ce qui concerne les droits de la personne et les ont même défendus dans d’autres domaines. La Suède et la Finlande ont toutes les deux affirmé qu’elles estiment qu’une convention est nécessaire. Le Danemark s’y est opposé au début, puis s’est tu par rapport à ce sujet depuis, tandis que la Norvège l’a à peine abordé.
« Lorsque des pays dont les réputations relatives à la défense des droits de la personne dans d’autres domaines sont plutôt bonnes figurent sur cette liste, il faut poser des questions », explique Mme Sleap. « Pourquoi ne reconnaissent [-ils] pas qu’il s’agit aussi d’une question à laquelle il importe de prêter attention? J’estime que cela a grandement nui à l’avancement du processus. »
L’âgisme est partout
Les experts sont unanimes sur le fait que l’âgisme se cache derrière tous les problèmes systémiques auxquels les personnes âgées font face.
« L’un des éléments que j’ai discernés dans mon travail au fil des ans, c’est l’expérience commune de l’âgisme : c’est vraiment un enjeu universel », explique Mme Sleap. « Je pense que les facteurs qui contribuent à l’âgisme sont universels : notre peur de vieillir, la peur de la mort, les idéaux et les normes entourant la jeunesse. Ces facteurs sont communs à plusieurs cultures, même à des endroits où le discours prône fortement le respect des aînés. »
À cet effet, Mme Sleap souligne qu’une convention peut reconnaître cette expérience universelle et aborder ces enjeux à l’échelle mondiale.
Elle indique que la convention traverse un moment critique. Le Groupe de travail à composition non limitée présentera son rapport sur les lacunes qu’il a décelées dans le cadre international des droits de la personne et formulera des recommandations pour les combler.
« Nous devons inciter les États membres à reconnaître clairement qu’il y a des lacunes dans le système et qu’une convention est l’un des moyens d’y remédier », indique Mme Sleap. « Si cela se produit, cela permettra aux États en faveur de la convention d’aller de l’avant. Si la convention n’est pas reconnue, cela pourrait retarder le processus de quelques dizaines d’années. »